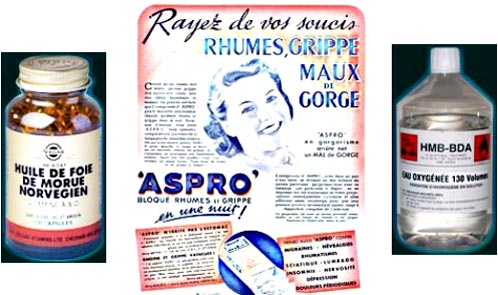voyage en enfance
L'enfance trouve son paradis dans l'instant. (Louis Pauwels)
Instants d'enfance
| J'ai dit au début de mon récit, que mes tendres années s'étaient partagée entre Sotteville et Grand Quevilly. Après cette chronique d'une rue défunte, qui m'a emmenée assez loin jusqu'à l'adolescence, je me retourne vers la toute petite enfance, là même où les souvenirs sont si flous, que le doute vous prend, à les évoquer. Pour autant, il est des goûts et des sensations qui ne mentent pas. Si je me rappelle avec certitude les commerçants ambulants qui passaient rue Fleury, je sais aussi que je n'ai pas rêvé ces instants de bonheur insaisissable, que représentait, chez ma grand-mère, le passage de la voiture du crémier avec ses petits suisses indémoulables, entourés d'un fin papier humide, et ses yaourts aigres conditionnés dans des pots en verre consignés. C'était une découverte pour moi, que ces fromages frais qu'on servait à l'arrière de la fourgonnette sur une planche faisant office de comptoir, un goût nouveau que je ne connaissais pas, enrichi d'une touche de crème fraîche, la saveur de l'enfance heureuse. Dès que le klaxon retentissait devant la porte, ma grand-mère attrapait son porte-monnaie et filait vers la barrière, non sans s'être muni d'un bocal en verre destiné à recevoir la crème épaisse puisée à la louche dans une lourde jarre de terre. Je la suivais de près pour ne pas manquer l'évènement. Le vendredi, passait aussi le poissonnier, et tous les matins, le boulanger bien sûr. Les autres courses, c'est mon grand-père qui s'en chargeait. Il prenait sa mobylette, me juchait sur la selle et marchait à côté de l'engin en le poussant. Il pouvait du coup m'emmener partout et charger les sacs plein de provisions sur le porte-bagages. Nous allions régulièrement à l'économat, non loin de la gare de Sotteville. Ce grand magasin, une sorte de coopérative qui appartenait à la SNCF et auquel seuls les cheminots avaient accès, me paraissait immense. Mais j'étais si petite ! En tout cas, une chose retenait immanquablement mon attention : la vente du vin à la tireuse, dans une odeur âcre de piquette.
Le jeudi, mes grands-parents se rendaient ensemble au marché de Sotteville, avec moi, bien entendu. Pour réaliser de bonnes affaires, ils attendaient la fin de matinée où toujours quelque bonimenteur vantait sa marchandise devant une clientèle captivée qui se prenait au jeu des " il n'y en aura pas pour tout le monde..." et repartait chargée de la "bonne occasion du jour", lot de torchons pur lin, service de vaisselle en porcelaine, batterie de casseroles, épluche-légumes miracle, coupe-frites sans effort, ustensile quelconque devenu en un tour de main, incontournable. Mes parents eux, se débrouillaient entre
commerçants ambulants, modestes boutiques, magasins "Coop"
où ils trouvaient à acheter à peu près
tout ce dont nous avions besoin et le marché de la demi-lune
à Petit-Quevilly. Restait ensuite à faire rentrer
dans la cave, les pommes de terre pour la saison, pommes de
terre qu'au printemps j'aidais mon père à dégermer,
sinon elles se flétrissaient et se seraient gâtées.
C'est mon oncle qui venait nous les livrer avec son camion.
Il aidait ma grand-mère paternelle (veuve depuis des
années) dans son travail à la graineterie située
à Elbeuf, en face de l'école des filles Racine,
qui en 1986 fusionna avec l'école des garçons
Voltaire, pour devenir Mouchel établissement mixte.
|
| Les
grands immeubles actuels n'existaient pas encore dans la rue
de la République alors bordée de vieilles maisons
avec des cours intérieures, comme il en reste actuellement
dans certains quartiers d'Elbeuf. Un de mes oncles maternels livrait le charbon
à la tonne chez mes grands-parents de Sotteville. Chez
moi au contraire, on n'en achetait pas beaucoup, car mon père
récupérait du bois de chauffage sur la Seine,
à l'aide du "crapaud" de sa grue, pour que
cela revienne moins cher. C'est ainsi que chaque soir, au delà
de ses dix heures de travail quotidien, il cassait du bois jusqu'à
l'heure du repas, pour assurer le chauffage du lendemain. De
ce fait, mes parents mangeaient tard et nous les filles, nous
dînions seules, avant eux. Par contre, l'été
nous avions plus souvent la chance de partager leur repas, c'était
une vraie fête, davantage encore quand cela se passait
sous la tonnelle... Cette cuisinière, il fallait l'allumer
chaque matin, papier, petit bois et bûches, dans la froidure
que la nuit avait apportée, dans l'odeur des allumettes
craquées et des cendres froides qu'en sortant le long
tiroir-cendrier on allait vider dans le jardin ou répandre
sur le trottoir les jours de neige pour parer aux glissades
des passants. On en profitait pour remplir le seau à
charbon. Un coup de tisonnier dans les grilles du côté,
un réglage à la clé du tuyau de poêle
pour en assurer le tirage et une fois par semaine, avant l'allumage,
le nettoyage du dessus de la cuisinière au "Zébracier"
et à la toile émeri ou à la laine d'acier. |